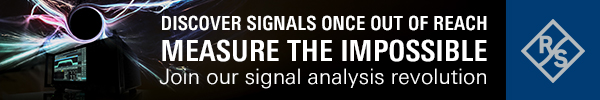- Biomemory, société française spécialisée dans le stockage de données ADN, a réalisé une levée de fonds de série A de 18 millions de dollars.
- Le tour de table a été conduit par Crédit Mutuel Innovation, avec la participation de l’investisseur historique du fonds French Tech Seed géré pour le compte de l’Etat français par Bpifrance dans le cadre de France 2030 et de nouveaux investisseurs.
- Avec sa solution de stockage sur ADN, la société promet d’accroître drastiquement la durée de vie des données, tout en réduisant l’encombrement des systèmes de stockage et la consommation énergétique des centres de données.
- Biomemory prévoit d’étendre sa technologie de stockage de données moléculaires à l’échelle de l’exaoctet d’ici à 2030 pour la déployer dans les centres de données.
- L’entreprise française a l’ambition d’offrir une durée de vie éternelle aux données, tout en réduisant l’empreinte spatiale de plusieurs ordres de grandeur. Elle espère même que sa technologie puisse, à terme, surpasser les systèmes d’archivage traditionnels en termes de vitesse.
Spin-off de l’Université de la Sorbonne et fondée en 2021 à Paris, Biomemory met la biotechnologie au service des technologies de l’information. L’entreprise française se concentre sur le développement d’une baie de stockage sur de l’ADN destinée aux centres de données. Pour se faire, elle produit des fragments d’ADN, biosourcés, biocompatibles et biosécurisés qui peuvent être stockés sous forme de polymères inertes pendant des milliers d’années sans apport d’énergie.
Plutôt que d’utiliser un support électronique tel qu’un disque dur, l’entreprise code les 0 et les 1 sur ces molécules constitutives du vivant. Cette technologie présente d’indéniables atouts : moindre consommation énergétique, davantage de stabilité dans le temps et moindre encombrement par rapport aux solutions existantes.
Transformation des bits en séquence ADN
Le processus d’encodage des données numériques repose sur la transformation les 0 et 1 en une séquence ADN constituée de quatre lettres (l’adénine A, la thymine T, la guanine G et la cytosine C) sur une bactérie. « S’il est relativement aisé de convertir des 0 et des 1 en ATCG (adénine, thymine, cytosine et guanine ; les quatre bases de l’ADN), il est plus difficile de le fabriquer, puis de le décoder ; c’est ce sur quoi nous travaillons », apporte Stéphane Lemaire, directeur de recherche CNRS au Laboratoire de Biologie Computationnelle Quantitative (LCQB, CNRS / Sorbonne Université), cofondateur et directeur scientifique de Biomemory. Pour y parvenir, un système d’impression basé sur des imprimantes à jet d’encre industrielles a été mis au point : « Nous avons créé seize encres ADN différentes et quatre enzymes qui permettent de fabriquer l’ADN dont nous avons besoin pour stocker les informations », indique Stéphane Lemaire. Et pour ce faire, Biomemory a opté pour du sucre biosourcé afin de ne pas recourir aux traditionnelles solutions à base de produits pétrochimiques.
Biomemory a développé un algorithme chargé d’encoder les fichiers numériques vers le brin d’ADN et créé un système de gestion de fichiers pour l’allocation des données. Elle doit cependant relever deux défis majeurs : la lecture du brin ne peut s’effectuer qu’une seule fois et le processus d’écriture est très chronophage.
Un exaoctet de stockage par armoire
Cependant, après le lancement l’année dernière de sa carte de stockage d’ADN, Biomemory a démontré la viabilité et le potentiel de sa technologie. Ce financement permettra à l’entreprise d’achever le développement de la première génération de son dispositif de stockage de données optimisé pour ses processus biotechnologiques, de nouer des partenariats avec des acteurs de l’industrie et des fournisseurs de services Cloud, de recruter des spécialistes en biologie moléculaire et en ingénierie, et d’étendre ses recherches sur ses solutions moléculaires.
Lors de l’édition 2024 de la manifestation VivaTech, Biomemory a présenté le premier exemplaire de son armoire de stockage destinée aux centres de données. Elle pourra stocker un millier de cartes de stockage ADN dont la densité sera augmentée jusqu’à un pétaoctet par carte. Ce qui permettrait d’atteindre un exaoctet de stockage par armoire. « C’est l’équivalent de plusieurs centaines de milliers de disques », souligne Stéphane Lemaire.
Le volume des données stockées par les data centers double tous les deux ans. Si bien qu’en 2040, l’espace requis pour accueillir le nombre de centre de données pourrait occuper une surface aussi vaste que l’Islande. Avec ses cartes de stockage ADN l’entreprise française compte donc se faire une place sur un marché mondial en forte progression qui devrait peser 390 milliards de dollars d’ici à 2028.